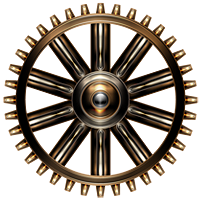


Petite histoire de nos unités de temps
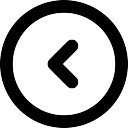
-46
Réforme Julienne
 Avec l'aide de Sosigène d'Alexandrie, Jules César établit un calendrier de 12 mois pour un total de 365 jours avec un jour bissextile intercalé tous les quatre ans.
Avec l'aide de Sosigène d'Alexandrie, Jules César établit un calendrier de 12 mois pour un total de 365 jours avec un jour bissextile intercalé tous les quatre ans.
Ce jour supplémentaire est souvent présenté comme un doublement du 24 février, la meilleure preuve étant son nom, qui nous a donné bissextile : le 24 était selon la méthode de comptage des Romains le 6e avant les calendes de mars (sextilis ante calendes martias), et le jour supplémentaire a été nommé bis sextilis ante calendes martias.
En tant que pontifex maximus, César avait la charge de fixer le calendrier. La réforme julienne fut introduite à son initiative en 46 av. J.-C. (708 depuis la fondation de la Ville (Rome), ab Urbe condita, AUC) et entra en application en 45 av. J.-C. (709 AUC). Elle fut établie après consultation de l'astronome Sosigène d'Alexandrie et probablement conçue pour approcher l'année tropique, déterminée depuis au moins Hipparque.
Ainsi pour résumer, cela donne :
Le calendrier conserve les douze mois du calendrier romain républicain ;
Le début de l'année consulaire est fixé au 1er janvier (date d'élection des Consuls de Rome) à la place de Mars, comme établi depuis 153 av. J.-C. ;
L'année normale comporte 365 jours, et une année bissextile tous les 4 ans comporte un jour de plus ;
Martius, Maius, Quintilis et October restent des mois pleins de trente-et-un jours ;
Trois mois caves (Ianuarius, Sextilis et December) deviennent des mois pleins de trente-et-un jours ;
Chaque autre mois cave gagne un jour, sauf février.
Ce sera le calendrier Julien utilisé jusqu'au 16e siècle et encore maintenant par la République monastique du mont Athos, ainsi que par cinq Églises orthodoxes : les Églises orthodoxes de Jérusalem, de Russie, de Georgie, de Macédoine, de Serbie ; et marginalement par des Berbères en Afrique du Nord.
Le calendrier copte utilise la même structure que le calendrier julien avec quelques variantes d'application.
Réalisation Webmaster : Olivier Greindl Contact